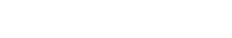Article – Quand le silence devient un problème. Quelques réflexions juridiques sur l’alerte à l’hôpital
Brigitte de Lard-Huchet, directrice du centre de droit JuriSanté du CNEH
Article publié dans la revue Gestions hospitalières, n°648, août-septembre 2025
Depuis quelques années, la question de l’alerte s’impose avec force, dans le monde hospitalier comme ailleurs. Entre protection des personnes vulnérables et préservation du secret médical, entre devoir de transparence et risque d’omerta, les professionnels hospitaliers naviguent dans un paysage juridique complexe et mouvant. La multiplication des dispositifs – du signalement des événements indésirables à la protection renforcée des lanceurs d’alerte – redessine les contours de la responsabilité médicale et managériale.
Respect de l’intimité et protection de la vie privée sont les maîtres mots quand il s’agit de prendre en charge le patient. L’hôpital devient ainsi un espace de confidentialité et, au-delà du bruit des machines, des échanges des équipes et d’un quotidien parfois agité, le lieu d’un certain silence. Mais en coulisses, une révolution court à bas bruit. Les notions de responsabilité individuelle et collective se transforment, au gré de l’idée de la transparence, et donc de l’alerte. Si la notion de signalement n’est pas révolutionnaire dans le monde de la santé, elle prend aujourd’hui un nouveau souffle. Les dispositifs ne concernent pas uniquement les patients puisque certains textes en la matière ont une portée générique et peuvent s’appliquer, à l’hôpital, de façon égale à des situations très variées : prise en charge du patient, management des professionnels, organisation des activités et des équipements, gestion financière… Car l’hôpital est à la confluence d’enjeux majeurs qui rendent l’alerte inhérente à son fonctionnement : protection du patient dans sa dimension de vulnérabilité, défense des valeurs du service public, exercice de missions d’intérêt général, évolution des exigences managériales… Dans ce contexte, le dysfonctionnement doit être signalé, et le silence n’est plus de mise. Sur le terrain, la réalité est différente. Et amène à réinterroger la différence entre silence… et omerta ?
Briser le silence : l’alerte comme un devoir
C’est vrai : la plupart des textes relatifs au signalement ouvrent aux professionnels (de santé notamment), dans le champ de la maltraitance, un droit d’option, entre le silence et la parole. C’est le cas par exemple de l’article 226-14 du Code pénal, qui autorise (sans l’imposer), la levée du secret professionnel à « celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ». Histoire de ménager la chèvre du secret professionnel et le chou de la nécessaire protection des personnes victimes de maltraitance.
Pour autant, l’alerte se mue en devoir, à travers un autre biais, celui de porter assistance à une personne en péril, qui peut prendre la forme d’une action personnelle, ou de la provocation d’un secours, autrement dit d’une alerte [1]. Cela sans compter les textes spécifiques, tels que l’obligation de signalement des évènements indésirables graves qui s’impose à tout professionnel de santé, établissement de santé ou établissement et service médico-social ayant constaté soit une infection associée aux soins, dont une infection nosocomiale, soit tout événement indésirable grave associé à des soins, dans le cadre de soins réalisés lors d’investigations, de traitements, d’actes médicaux (art.L.1413-14 du Code de la santé publique – CSP).
Que dire encore de l’article 40 du Code de procédure pénale (CPP) ? À l’hôpital, il est sans doute devenu le canal principal de l’alerte : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Ici, l’alerte s’impose au fonctionnaire. Et si ce texte est d’application malaisée [2], il n’en est pas moins très largement utilisé, notamment par les directions hospitalières. Au point que le juge ne reprochera pas à l’établissement d’avoir brisé le silence en recourant à l’article 40 CPP pour signaler des faits de harcèlement sexuel [3], et ce même si l’instruction pénale aboutit finalement à un non-lieu.
A minima, le périmètre de l’alerte doit être clarifié, tant le sujet peut s’avérer vaste, et les réglementations nombreuses. Le droit [4] d’alerte et de retrait reconnu au travailleur (et à l’agent public !) par l’article L.4131-2 du Code du travail en cas de danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité relève en effet d’une approche et d’un champ d’application bien différents des autres dispositifs juridiques précités. Le constat qui en découle est sévère : les normes qui imposent l’alerte sont nombreuses, touffues, complexes. À l’hôpital, leur multiplication peut rendre cette alerte plus difficile.
Piste de réflexion n°1. Pour responsabiliser les acteurs hospitaliers à leur devoir d’alerte, il faudra d’abord clarifier la notion d’alerte, et son champ d’application. À défaut de quoi, le silence a de beaux jours devant lui
Protéger le bruyant, c’est permettre l’alerte
Rappelons le cadre : un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement (article 6 de la Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).
Ce qui est nouveau, c’est l’attachement que manifeste désormais la loi à protéger celui qui alerte. Car l’alerte, si elle est un devoir, ne se décrète pas. Elle doit bénéficier de vents favorables, à défaut desquels elle étouffera.
La loi Sapin 2 [5] avait déjà posé en 2016 une première reconnaissance des lanceurs d’alerte. Sous l’influence du droit communautaire, elle a été enrichie en 2022.
On retiendra la protection plus qu’étendue offerte au lanceur d’alerte par l’article 10-1 de cette loi, en particulier :
- l’exclusion de la responsabilité civile pour les dommages causés par le signalement ou la divulgation publique ;
- l’irresponsabilité pénale liée à la violation d’un secret protégé dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause ;
- la protection judiciaire, avec une possible prise en charge des frais d’instance ;
- le soutien psychologique ;
- et surtout, pour les professionnels, notamment les agents publics, l’interdiction des mesures de représailles, menaces ou tentatives de recourir à ces mesures, qui pourraient impacter la carrière de l’agent, notamment, sanction disciplinaire, refus de promotion, coercition, refus de formation, non-renouvellement du contrat de travail…
On doit la première reconnaissance d’un lanceur d’alerte dans le monde du travail à un conseil de prud’hommes (CPH Lyon, 17 avril 2019, R.G. n° 19/00087), qui a conduit à la réintégration d’un salarié sur son poste de travail. La Cour de cassation elle-même a reconnu en 2022 la nécessaire protection du lanceur d’alerte, malgré des faits antérieurs à la loi Sapin 2 dans sa première version : « En raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales ou des manquements à des obligations déontologiques prévues par la loi ou le règlement, est frappé de nullité » (Cour de cassation, civile, chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057).
Dans la fonction publique hospitalière, ce n’est pas encore le grand soir pour le lanceur d’alerte. Le juge administratif en est pour l’heure à reconnaître le statut de lanceur d’alerte, confirmant par exemple la sanction disciplinaire d’un infirmier de centre hospitalier pour manquement à ses devoirs de discrétion professionnelle. Il est vrai que le signalement que celui-ci avait réalisé auprès du maire de la commune puis du journal local sur les températures très élevées et l’insuffisance de climatiseurs dans l’Ehpad ou il travaillait n’avait pas répondu aux conditions de fond de la loi pour permettre la qualification de lanceur d’alerte (CAA de Lyon, 30/04/2025, 23LY02694).
Piste de réflexion n°2. Pour protéger le lanceur d’alerte, il faudra d’abord que celui-ci maîtrise les conditions dans lesquelles il peut demander une reconnaissance à ce titre, et le bénéfice de la protection qui en découle… Vaste chantier de pédagogie pour les établissements !
Organiser les mécanismes d’alerte
Encore une couche sur le mille-feuille ? Il faudra en tous les cas intégrer ce nouveau cadre juridique du lanceur d’alerte dans un arsenal existant de procédures de signalement. Car la loi Sapin 2 ne se contente pas d’instaurer un cadre protecteur pour le lanceur d’alerte. Elle développe également à la charge des personnes morales l’obligation d’adopter une procédure de traitement des alertes. L’hôpital, en tant que personne morale de droit public de plus de 50 agents, sera ainsi tenu d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. En bref, cette obligation recouvre notamment :
- la mise en place d’un canal de réception et de transmission des alertes ;
- la désignation d’un référent pour recevoir ces alertes, et les qualifier au regard de la loi ;
- une démarche structurée de traitement du signalement, encadrée dans des délais réglementaires ;
- des garanties offertes au lanceur d’alerte, notamment en termes de confidentialité ;
- une communication sur les démarches entreprises, et l’aboutissement de la procédure conduite.
La procédure est lourde. Elle concernera également la majeure partie des établissements médico-sociaux de statut public, avec un niveau de contrainte juridique identique. Pas sûr d’ailleurs que la mutualisation des organisations, dans le cadre de coopérations ou à l’échelle d’un groupement hospitalier de territoire (GHT), simplifiera la tâche, tant le sujet garde une dimension très locale et propre à la culture de chaque structure.
Piste de réflexion n°3. Le véritable défi sera, pour les établissements hospitaliers, de faire coïncider cette nouvelle procédure avec toutes celles qui existent déjà (EIG, maltraitance, harcèlement, article 40 CPP…). Le chevauchement sera sans doute inévitable. En la matière, ce qui sera jugé sans doute, c’est l’efficacité des process évalués à l’aune de l’effectivité des signalements reçus et, surtout, des réponses apportées.
Notes
[1] Art.223-6 Code pénal.
[2] Quid par exemple des personnels médicaux qui ne sont pas fonctionnaires et que dire de l’absence de sanction en cas d’inexécution de l’article 40 CPP ?
[3] CAA Douai, 21/10/2010, 09DA00278.
[4] Et non le devoir, cette fois !
[5] Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.