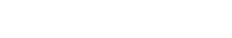Article – PMA post mortem: de la question de constitutionnalité à la question de société. A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 février 2025, n°499498
Céline Berthier et Aude Charbonnel, juristes, consultantes du centre de droit JuriSanté du CNEH
Article paru dans la revue Gestions hospitalières, n° 647 – juillet 2025
Mariage pour tous, procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes ou les femmes seules, gestation pour autrui (GPA)…, autant de questions de société sur lesquelles l’État français s’est positionné et a légiféré. Depuis la loi Bioéthique du 2 août 2021 [1], le cadre législatif est clair et précis : la PMA est autorisée dans le cadre d’un projet parental d’un couple, composé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes indépendamment de leur statut matrimonial ou de leurs orientations sexuelles, ou d’une femme seule. Le principe de la GPA a quant à lui été écarté et demeure interdit en France. Malgré ce cadre aux apparences bornées, un sujet s’invite régulièrement dans les débats : celui de la PMA post mortem, c’est-à-dire la possibilité pour une femme de poursuivre un parcours de PMA alors que son partenaire est décédé.
Sur le principe, les dispositions du Code de la santé publique [2] (CSP) sont sans équivoque : un projet de PMA ne peut se poursuivre en cas de décès de l’un des membres du couple.
Si le texte est clair, son application n’est pas sans difficulté au regard des situations paradoxales qu’il peut engendrer : ainsi, une femme ayant perdu son conjoint ne peut poursuivre son parcours de PMA alors qu’une femme célibataire peut mener un projet parental seule.
Au coeur des débats, le questionnement sur les libertés fondamentales de ces femmes, de leur droit à mener une vie privée familiale et à être traitées sur un pied d’égalité. Le refus d’accorder aux unes ce qui est possible aux autres pourrait-il être constitutif de discrimination ?
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité [3] (QPC) en ce sens, le Conseil d’État a joué son rôle de gardien du temple administratif pour se positionner sur ces sujets qui, s’ils peuvent trouver des réponses objectives du point de vue constitutionnel, n’en demeurent pas moins sensibles du point de vue
sociétal.
Une décision logique sur le champ de la QPC
S’étant vu refuser par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen la poursuite de son parcours PMA et l’implantation d’embryons après le décès de son mari, une femme a saisi le tribunal administratif d’une QPC [4] transmise au Conseil d’État concernant la conformité à la Constitution de l’article L. 2141-2 du CSP.
En l’espèce, la requérante soutenait que le 1° du quatrième alinéa de cet article L. 2141-2, lequel prévoit l’obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons en cas de décès de l’un des membres du couple, méconnaissait les articles 2 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 relatifs à la liberté et à l’égalité de tous devant la loi, ainsi que le dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatif aux conditions de développement de l’individu et de la famille.
Pour répondre à cette question, le Conseil d’État a repris les termes de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique et son article 1er qui fonde l’assistance médicale à la procréation sur le projet parental du couple (composé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes) ou de toute femme non mariée dont l’accès n’est pas conditionné par le statut matrimonial ou l’orientation sexuelle. Il rappelle ainsi que, depuis 2021, c’est ce projet parental initial qui détermine l’accès à la PMA et que, lorsque ce projet parental est porté par un couple, ses deux membres doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert d’embryons.
Sous ce raisonnement, le projet parental disparaît avec le décès de l’un des deux membres du couple et, ainsi, tel que prévu par le CSP, la poursuite du parcours PMA n’est plus possible sans qu’il soit porté atteinte à la liberté, au droit à la vie privée ou au droit de mener une vie familiale normale du couple concerné.
Le Conseil d’État rappelle que le projet parental mené par une femme seule, prévu dès l’origine avec une seule filiation maternelle, est différent de la situation d’une femme ayant perdu son conjoint sans qu’il soit ainsi porté atteinte aux droits précités dans la poursuite de ce parcours PMA.
C’est donc sur ces bases que le Conseil d’État a statué sur le fait que la question de constitutionnalité soulevée ne répondait pas aux critères de nouveauté ni de caractère sérieux et n’avait ainsi pas lieu d’être renvoyée à l’examen du Conseil constitutionnel.
Sur le plan juridique, le raisonnement est clair et limpide. L’argumentation reposant sur le projet parental initial tel que prévu par la loi Bioéthique est clairement posé et la réponse du Conseil d’État s’inscrit dans la droite ligne du raisonnement du droit français sur l’impossibilité de la PMA post mortem.
C’est donc en toute logique que le Conseil d’État a écarté ici cette QPC, faisant écho à d’autres décisions en ce sens [5], estimant que les droits fondamentaux invoqués n’étaient pas bafoués.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a d’ailleurs validé cette position du Conseil d’État dans une décision du 14 septembre 2023 [6] en statuant que le refus de la France de PMA post mortem ou d’exporter des gamètes vers un État autorisant la PMA post mortem ne portait pas atteinte de façon disproportionnée aux droits fondamentaux mais relevait de la marge d’appréciation des États membres en matière de bioéthique.
Pas d’atteinte aux droits fondamentaux ni de caractère nouveau ou sérieux pour le dispositif législatif de la PMA clairement encadré depuis 2021, la position du Conseil est donc sans surprise sur ce point.
Jouant pleinement son rôle de filtre sur les questions prioritaires de constitutionnalité en matière de droit public et de gardien de l’ordre juridique établi en matière de bioéthique, le Conseil d’État est là où il était attendu.
Aurait-il pu cependant s’autoriser un pas de côté, au regard notamment de la position de la CEDH sur la nécessaire cohérence du cadre juridique, et du paradoxe de situation instauré depuis 2021 avec la possibilité pour une femme célibataire de mener seule un projet de PMA alors que ce projet sera refusé à une femme en deuil ?
Quand la QPC ne passe pas. Un débat en suspens ?
Quid du principe d’égalité ?
Ce moyen est écarté par le Conseil d’État au motif qu’il a été soulevé trop tard : « Le grief tiré de la méconnaissance par les dispositions contestées du principe d’égalité devant la loi résultant de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen n’a pas été soumis au tribunal administratif par la question prioritaire de constitutionnalité transmise en l’espèce. » Il s’agit d’un point de procédure essentiel car « ne peut être présenté pour la première fois devant le Conseil d’État, saisi, en application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, d’une ordonnance de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d’autres dispositions ou principes constitutionnels».
Nous ne pouvons que regretter le défaut d’invocation du principe d’égalité au cours de la procédure et, par conséquent, son analyse. Ce principe constitue pourtant un argument central et solide dans le débat juridique sur la PMA post mortem. Il découle du principe d’égalité deux obligations : l’interdiction de discrimination et l’application uniforme de la règle de droit.
L’égalité est un principe à valeur constitutionnelle [7]. L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dispose que la loi doit être la même pour tous. Cela signifie que les personnes placées dans des situations comparables doivent être traitées de manière identique. Le dispositif juridique actuel ne crée-t-il pas une discrimination injustifiée entre les femmes « seules », qu’elles soient célibataires ou veuves ?
Toutefois, le Conseil constitutionnel a, à plusieurs reprises, souligné que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général dès lors que les différences de traitement qui en résultent sont en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit [8] ».
C’est donc au législateur puis au juge qu’il appartient de caractériser ces différences de traitement, de préciser les exigences de l’intérêt général et la cohérence de ce choix.
Concernant notre sujet, certes, en 2019, le Conseil d’État avait affirmé que « le principe d’égalité n’est pas méconnu dès lors que la femme seule et la femme dont le conjoint ou le concubin est décédé sont placées dans des situations différentes, notamment au regard de leur capacité à consentir librement à une AMP [PMA] et au regard de la filiation de l’enfant [9] ». Le principe d’égalité a pu être appréhendé de façon différente dans le temps par les Sages sur des questions de société. À titre d’illustration, le mariage entre personnes de même sexe. En l’espèce, le Conseil constitutionnel a validé à la fois des dispositions ayant pour effet d’interdire le mariage entre personnes de même sexe et d’autres autorisant au contraire cette union [10], et ce sur la base d’une différence de situation entre les couples formés d’un homme et d’une femme et les couples de même sexe. Dans le cas de la PMA, son ouverture à des femmes seules sans accorder aux veuves la possibilité de poursuivre un projet parental ne constitue-t-elle pas une atteinte au principe d’égalité et une discrimination ? La distinction faite entre ces deux situations correspond-elle au but légitime recherché, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant ?
La loi Bioéthique a été adoptée définitivement le 29 juin 2021. Le Conseil constitutionnel en avait été saisi le 2 juillet par plus de 60 députés. Ceux-ci contestaient notamment certaines dispositions de ses articles mais pas celles relatives à la PMA. Par conséquent, en l’absence d’un examen en profondeur de la question constitutionnelle, la conformité de ce texte à la Constitution n’est que supposée. Une QPC aurait donc permis de trancher un débat sensible car, en exhumant les prises de position, on mesure combien ce sujet, autant politique que juridique, interroge.
Quid de la cohérence des positions ?
Rappelons qu’en tant que Haute Juridiction de l’ordre administratif, le Conseil d’État a autorisé le transfert de gamètes à l’étranger en vue d’une insémination post mortem [11], en 2016 (donc avant la réforme). Il a en effet considéré que, dans des circonstances exceptionnelles, une application trop rigide de la loi française pouvait entraîner une ingérence disproportionnée au regard de la Convention européenne des droits de l’homme. À noter que, dans cette affaire, le conjoint décédé avait autorisé le transfert et que la requérante s’était installée en Espagne, son pays d’origine.
Ce même Conseil d’État, en 2019, dans son avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique, avait estimé que, « dans un souci de cohérence d’ensemble de la réforme », il est recommandé au gouvernement d’autoriser le transfert d’embryons et l’insémination post mortem, « dès lors que sont remplies les deux conditions suivantes : d’une part une vérification du projet parental afin de s’assurer du consentement du conjoint ou concubin décédé ; d’autre part un encadrement dans le temps (délai minimal à compter du décès et délai maximal) de la possibilité de recourir à cette AMP [12] ».
À noter qu’au cours des débats, une cinquantaine d’amendements en faveur de la PMA post mortem avaient été déposés devant l’Assemblée nationale et le Sénat. Ces amendements ont tous été rejetés.
Par ailleurs, le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE) s’est penché à plusieurs reprises sur les aspects éthiques de la PMA post mortem [13] et continue de s’interroger : « Faire naître un enfant orphelin n’a rien d’anodin, mais puisque la loi française autorise désormais toute femme seule à faire appel à un don de sperme, doit-on maintenir l’interdiction du recours au sperme du conjoint décédé ou le recours à l’embryon formé avec lui dans le cadre d’un projet parental, dans un délai raisonnable après le décès, et si un consentement antérieur a été signé ? [14] »
On ajoutera à ces éléments de réflexion la remarque de la CEDH dans un obiter dictum [15] lors de sa décision de 2023 [16] : « La loi du 2 août 2021, en ouvrant l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules non mariées, pose de manière renouvelée la pertinence de la justification du maintien de l’interdiction dénoncée par les requérantes. » La Cour rappelle en effet que malgré l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de bioéthique, « le cadre juridique mis en place par ces États doit être cohérent ».
Pour toutes ces raisons, un débat constitutionnel sur une question bioéthique majeure en 2025 aurait été intéressant. La pertinence du caractère absolu de l’interdiction de la procréation post mortem en droit français, qui empêche non seulement de mettre en oeuvre une telle pratique en France mais également de procéder à l’exportation des gamètes (insémination post mortem) et/ou des embryons (gestation post mortem) à l’étranger, devrait être réinterrogée… dans un cadre éthique strict !
Conclusion
Parmi les questions qui devront être débattues lors des prochains États généraux de la bioéthique en 2026 figure le sujet de la PMA post mortem [17]. À défaut d’une censure par le Conseil constitutionnel, le débat sera peut-être tranché à la faveur d’une nouvelle loi Bioéthique.
Notes
[1] Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.
[2] Art. L.2141-2 du CSP.
[3] Conseil d’État, 25 février 2025, n°499498.
[4] Dispositif instauré par une réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, la QPC est la possibilité pour tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel sur la conformité d’une disposition législative, dans un litige qui le concerne, à la Constitution.
[5] Cette saisie n’est pas directe mais passe par le Conseil d’État, s’agissant des dispositions relevant du droit administratif, qui revêt dans ce cas le rôle de filtre s’agissant des questions à transmettre ou non au Conseil constitutionnel. Trois conditions s’imposent pour que la question soumise devienne une QPC et soit transmise au Conseil constitutionnel:
- la disposition législative critiquée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
- la disposition législative critiquée n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil
constitutionnel ; - la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
[5] Conseil d’État, décision n°421333 du 13 juin 2018, et Conseil d’État, décision n°497323 du 28 novembre 2024.
[6] CEDH, n°2296/20.
[7] Cons. const., déc. n°73-51 DC du 27 décembre 1973, loi de finances pour 1974.
[8] Cons. const., déc. n° 96-380 DC du 23 juillet 1996, loi relative à l’entreprise nationale France Télécom.
[9] Conseil d’État, Assemblée générale, section sociale, section de l’intérieur n° 3 9 7. 9 9 3, séance du 18 juillet 2019, avis sur un projet de loi relatif à la bioéthique, NOR : SSAX1917211L.
[10] Cons. const., déc. n° 2010-92 QPC du 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre et Cons. const., déc.
n° 2013-669 DC du 17 mai 2013, loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe.
[11] Conseil d’État, Assemblée, 31 mai 2016, n°396848.
[12] Conseil d’État, op. cit.
[13] Comité consultatif national d’éthique, « Avis 113 – La demande d’assistance médicale à la procréation après le décès de l’homme faisant partie du couple », 10 février 2011 et « Avis 129 – Contribution du Comité consultatif national d’éthique à la révision de la loi de bioéthique 2018-2019 », 18 septembre 2018.
[14] Comité consultatif national d’éthique, « Avis 149 – Baisse de la natalité et de la fertilité : des réponses différentes, des enjeux d’éthique partagés », 3 avril 2025.
[15] Littéralement « soit dit en passant », l’obiter dictum est issu de la procédure anglo-saxonne et consiste pour une juridiction suprême à insérer dans un arrêt, une opinion étrangère à l’espèce, tout en participant à la portée de la décision rendue.
[16] CEDH, op. cit.
[17] CCNE, op. cit.