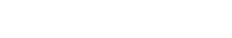Article – Les gardes administratives mutualisées en EHPAD publics, entre incertitude juridique et préoccupations organisationnelles
Aude Charbonnel, juriste, consultante au centre de droit JuriSanté du CNEH
Article paru dans la revue Gestions hospitalières n° 645 – avril 2025
La garde mutualisée entre plusieurs établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) autonomes relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) se révèle souvent être une nécessité afin de soulager les chefs d’établissements tout en répondant aux exigences de permanence administrative. Dans un tel dispositif, plusieurs directeurs s’entendent pour effectuer des gardes sous forme d’astreintes à tour de rôle afin de gérer les urgences au sein des établissements partenaires. L’objectif est d’apporter une réponse pour toute situation exigeant une réaction immédiate en raison de ses effets sur la sécurité, la santé ou le confort des résidents, sans oublier le panel de problématiques liées aux ressources humaines. La garde mutualisée implique donc de répondre à des situations variées, de manière opérationnelle et juridiquement sécurisée. Sa mise en place relève d’une démarche à la fois juridique et organisationnelle, qui peut soulever des interrogations.
Un cadre juridique qui questionne
Une certitude : la convention de gardes mutualisées
Le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière prévoit que les personnels de direction peuvent « assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d’affectation, mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 […]. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements ».
La convention de mutualisation est donc prévue par un texte et constitue un élément indispensable à toute mise en oeuvre de gardes mutualisées entre Ehpad. Elle constitue un accord prévoyant que le directeur de garde, selon une rotation clairement définie, a vocation à intervenir sur l’ensemble des établissements signataires en cas d’urgence.
La rédaction de ce document juridique doit répondre aux exigences habituelles des conventions : visas, préambule, parties concernées, modalités opérationnelles, engagements contractuels, durée, modalités de résiliation, responsabilité…
Mais une fois la convention rédigée et signée et le tour d’astreinte défini, il demeure une réelle difficulté juridique : jusqu’où un directeur peut agir dans le cadre des gardes mutualisées ? Si la convention organise la coopération des chefs d’établissement sous forme d’accord, elle ne résout pas la question de la compétence juridique. En effet, chaque directeur demeure responsable de sa structure. Le directeur d’astreinte prend des mesures conservatoires ou assure le lien avec les autorités (police, procureur de la République, agence régionale de santé…), en dehors des heures ouvrées. La convention encadre donc l’entraide entre directeurs mais ne constitue pas un fondement juridique suffisant pour qu’un directeur d’un autre établissement prenne un acte juridique engageant formellement l’établissement. Il faut donc une base légale plus solide qu’un simple accord conventionnel. Or, le décret de 2007 ne fait pas référence à une quelconque délégation de signature.
Une délicatesse : les délégations de signature croisées
Pour mémoire, une délégation de signature, pour être valable, répond à des exigences fortes : elle doit être encadrée par un texte, respecter des procédures de publicité, être limitée dans son objet et dans le temps. Ainsi, l’article L. 315-17 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) prévoit que le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. L’article D. 315-67 du CASF précise que « le directeur d’un établissement public social ou médico-social peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, déléguer sa signature au sein de l’établissement qu’il dirige à un ou plusieurs directeurs membres de l’équipe de direction ou appartenant à l’un des corps de directeurs de la fonction publique hospitalière ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou en leur absence, dans la catégorie B ». Cette délégation est possible pour « les actes de gestion courante relatifs aux besoins de fonctionnement de l’établissement, à l’accueil et au suivi des personnes bénéficiaires d’une prise en charge et aux personnels ».
Enfin, l’article D. 315-68 du CASF précise que toute délégation doit être écrite et mentionner :
● le nom et la fonction de l’agent auquel la délégation est donnée ;
● la nature des actes délégués, les matières précises de la délégation ainsi que sa durée ;
● le cas échéant, les conditions et réserves dont le directeur juge opportun d’assortir la délégation ;
● l’obligation pour le délégataire de rendre compte des actes pris dans l’exercice de cette délégation.
Les délégations doivent être formalisées et diffusées. À noter que la Cour de cassation a récemment rappelé les exigences relatives au contenu des délégations de signature pour les établissements publics de santé et les conséquences en cas d’absence ou d’incomplétude (Cass. 1re civ., 16 octobre 2024, n° 2321141 et 2311591).
Le directeur d’Ehpad peut donc déléguer sa signature à un agent placé sous son autorité. Mais, quand bien même plusieurs Ehpad autonomes entretiendraient des liens étroits et de proximité géographique, aucun texte ne prévoit expressément la possibilité d’une délégation de signature entre directeurs. Dès lors, en l’état actuel du droit, la délégation de signature d’un directeur d’Ehpad à un autre directeur d’Ehpad dans le cadre de gardes mutualisées apparaît juridiquement délicate. Un chef d’établissement ne peut mandater un homologue pour des actes engageants. Ainsi, toute délégation croisée repose sur une interprétation souple des textes, et par conséquent comporte un risque juridique.
Une alternative consisterait à formaliser un rapprochement des établissements au niveau de leur gouvernance : par exemple, une direction commune ou à organiser dans le cadre d’un groupement territorial social ou médico-social (GTSMS). À noter également qu’en cas d’absence prolongée d’un directeur, l’agence régionale de santé (ARS) peut désigner un directeur par intérim si la continuité de gestion ne peut être assurée autrement. Cette désignation temporaire est formalisée par un arrêté afin de garantir la stabilité de l’établissement mais n’apparaît pas être la solution pour les gardes. Alors, à l’extrême, faudra-t-il que les Ehpad entrent dans une dynamique de fusion ou soient rattachés à un centre hospitalier pour que les directeurs puissent avoir une charge juridique et mentale acceptable ? Il s’agit là de montages juridiques complexes difficiles à envisager uniquement pour pallier les limites des textes sur la délégation de signature dans le cadre de gardes mutualisées en Ehpad ! Il faut raison garder et apporter un maximum de sécurité avec l’existant. C’est-à-dire bien cadrer et muscler sa convention de gardes mutualisées en la couplant avec des délégations de signature croisées, formalisées et diffusées, tout en admettant la fragilité juridique d’un tel dispositif. Préciser le champ des décisions prises par le directeur de garde : il ne doit pas y avoir de confusion sur la chaîne décisionnelle. La convention organise la coopération mais chaque établissement conserve bien son autorité propre. Toute décision structurante pour l’établissement et appelant la signature du directeur doit être différée au retour du directeur titulaire. À titre d’illustration, l’engagement d’une dépense réalisée par le directeur de garde doit être contresigné dès que possible par le chef d’établissement afin de sécuriser l’acte. Se pose également la question de la gestion des ressources humaines : le directeur de garde pourra-t-il prendre une décision écrite de suspension à l’égard d’un agent dans un contexte de violence ou de consommation d’alcool par exemple ? Un signalement effectué sur le fondement de l’article 40 du Code de procédure pénale suite à l’agression sexuelle d’un résident vulnérable par un soignant sera-t-il recevable comme tel par le procureur de la République ?
Enfin, une information du dispositif et de l’organisation retenue à l’ARS semble indispensable, en tant que garante de la bonne gestion des Ehpad. L’information de l’assureur de l’établissement paraît également opportune.
Un dispositif bien préparé et contractualisé permet d’assurer la continuité administrative tout en minimisant les risques juridiques.
Des outils organisationnels indispensables
Le rapport de garde
Un tel document n’est pas prévu par les textes mais il est essentiel. Un rapport de garde est un outil de traçabilité et de protection juridique aussi bien pour l’établissement concerné que pour le directeur qui assure la continuité administrative. Il permet également d’identifier les situations récurrentes en garde et donner ainsi lieu à la rédaction, ou à l’amélioration, de procédures, à une prise de position institutionnelle.
Les chefs d’établissement doivent en amont définir le support, les items, les modalités de communication et les règles de conservation de ce document.
En tout état de cause, il peut être pertinent, en cas de situation complexe, d’annexer au rapport de garde un rapport circonstancié complet.
La « mallette » de garde
Qu’elle soit « physique » ou dématérialisée, la mallette de garde peut se révéler indispensable pour le directeur de garde. Il doit en effet être « outillé » pour réaliser des gardes dans un établissement qui n’est pas le sien et lui permettre d’intervenir en vue du règlement rapide de la situation, respectueux de l’organisation définie dans la structure en amont ! Un accès aux procédures de l’établissement est indispensable pour fonder et sécuriser toute décision prise lors de la garde. Car les procédures sont la traduction de l’anticipation par l’établissement des situations à risque.
À titre d’illustration, dans le cadre de la gestion du personnel, les pouvoirs des directeurs de la FPH sont assez étendus pour organiser et maintenir la permanence des soins et l’accueil des résidents. Toutefois, les pratiques peuvent être différentes d’une structure à l’autre : quels sont les effectifs minimums de sécurité ? L’organisation d’une astreinte infirmière pour l’Ehpad, le cas échéant par un centre hospitalier, a-t-elle été mise en place ? Existe-t-il une procédure formalisée de gestion des situations d’effectifs insuffisants ?
Deux points de vigilance concernant les procédures :
● attention aux documents en format papier : un accès à distance aux procédures des établissements est pertinent pour garantir que le directeur de garde utilise bien la dernière version ;
● les procédures ne doivent pas annihiler le pouvoir de décision du directeur de garde. Ce dernier doit toujours raisonner en gestion de risque, en tenant compte des spécificités de la situation qui se présente à lui : il arbitre et fait le choix du risque juridique le moins élevé.
Une connaissance des lieux et un « brief » de qualité
Avant d’assurer une garde, il est conseillé au directeur sollicité de se familiariser avec les lieux, de connaître les circuits critiques (accès sécurisés, locaux techniques, poste de soins…), d’identifier les contacts clés, de s’assurer de l’accèsaux documents nécessaires (plan bleu, fiches réflexes, protocoles d’appel, procédure…), de vérifier les moyens d’accès (clés, badge, alarmes ?). Et de prévoir une passation formelle entre directeurs avec un état des lieux à date de la situation dans l’établissement : les effectifs, l’existence éventuelle de consignes pour les visiteurs permettant de protéger la santé du résident en cas d’épidémie locale n’affectant pas tous les Ehpad du territoire, les possibles dysfonctionnements… Et de veiller à bien informer l’ensemble des professionnels de la structure de l’organisation retenue durant les absences du chef d’établissement.
Conclusion
Toute cette anticipation devrait garantir la capacité du directeur de garde à gérer une situation d’urgence et à assumer ses responsabilités dans de bonnes conditions afin que le droit au repos et à la déconnexion ne soit pas théorique…, malgré un cadre juridique sur les gardes mutualisées à ce jour incomplet !